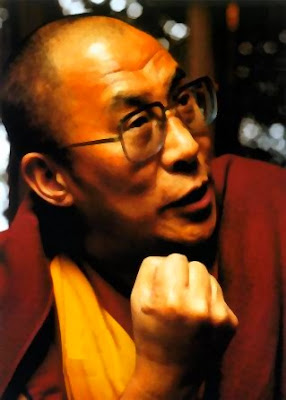Caricature de Gustav Meyrink par Olaf Gülbranston.
On m'a
souvent demandé comment j'ai pu, d'homme d'affaires que j'étais, me
transformer en écrivain du jour au lendemain. La première impulsion
fut la circonstance suivante : au sanatorium Lehmann j'avais fait la
connaissance de l'écrivain Oscar A.-H. Schmitz ; lorsque je lui
racontai deux ou trois expériences remarquables qui m'étaient
arrivées, il me dit : « Pourquoi n'écrivez-vous pas cela ? » —
« Comment fait-on ? » demandai-je. « Écrivez donc tout simplement
comme vous parlez », répondit-il. Je me mis au travail et composai
la nouvelle « le Soldat brûlant », et l'envoyai au Simplicissimus
qui l'accepta aussitôt. Depuis lors, tout ce que j'ai écrit a été
immédiatement publié soit par les revues, soit par les éditeurs.
Un
jour, le maître de mon destin m’asséna un coup de fouet...
L'impulsion
interne qui éveilla en moi ce talent de conteur est infiniment plus
curieuse. Je veux la décrire en détail, car elle m'a amené à
cette conviction que tout talent sommeille en tout homme, mais il
faut apprendre la méthode qui permet de l'éveiller. Quand on
applique la méthode inconsciemment, on ne peut développer qu'un don
dont les premières manifestations existaient déjà, de quelque
manière, dans la prime jeunesse. Pour ma part, je n'eus jamais dans
mon enfance aucune inclination pour la littérature ou pour la
poésie, je lisais sans discrimination tout ce qui me tombait sous la
main. Par la suite, mon amour de la lecture disparut complètement,
et je considérai que le sens de la vie résidait dans les intrigues
amoureuses, le jeu d'échecs et le canotage. Le maître de mon
destin, apparemment en grand souci à mon sujet en présence de tels
débuts, m'asséna un jour un coup de fouet si énergique que, à la
suite d'un chagrin d'amour et d'autres causes d'ordre sentimental, je
décidai de mettre fin à ma brève existence (j'avais alors
vingt-trois ans) en me faisant sauter la cervelle avec un revolver.
Un frôlement à la porte de ma chambre de célibataire interrompit
mon geste : le destin, sous les espèces d'un commis de librairie, me
glissait une brochure sous la porte. S'il y avait eu une boîte à
lettres à l'extérieur, il y a peu de chances que j'eusse été
vivant aujourd'hui. Je ramassai la brochure et la feuilletai :
spiritisme, histoires de revenants, sorcellerie ! Ce domaine, que je
n'avais connu jusqu'à ce jour que par ouï-dire, éveilla
immédiatement mon intérêt à tel point que j'enfermai le revolver
dans le tiroir en vue d'une occasion meilleure et que je décidai, au
lieu de bannir définitivement de ma vue, comme l'arme, mes trois
intrigues sentimentales révolues, de lancer avant tout l'embarcation
de ma vie à la découverte de ces régions inconnues dont la
brochure évoquait une si large part. Je mis à la mer. Une mer sans
limites d'ouvrages sur l'occultisme.
J'appris
à mes dépens que l'expérience vivante ne se trouve pas dans les
livres morts...
Au début
les vagues se soulevaient à des hauteurs terrifiantes : le destin
sous les espèces du libraire me submergeait littéralement
d'ouvrages spécialisés. Ce qui, au début, aurait pu être
considéré comme de la curiosité ou comme un intérêt superficiel
devint avec les années un ardent besoin de savoir, une soif
inextinguible qui me dévorait ! Je fus longtemps en proie à ce
besoin fatal commun à tous les hommes, et qui est de demander
conseil à d'autres dans l'illusion de s'enrichir de leurs
connaissances. Cela peut être valable dans une certaine mesure dans
le domaine des choses extérieures, mais échoue à chaque fois qu'il
s'agit de l'évolution intérieure de l'être humain. Ayant appris
que l'expérience vivante ne se trouve pas dans les livres morts, je
me mis à la recherche d'hommes susceptibles de me donner quelque
conseil. Le maître camouflé de mon destin prit l'initiative de m'en
donner l'occasion : il réussit à me faire entrer en contact de la
manière la plus curieuse avec des gens intéressants, pour la
plupart des étrangers, des Asiatiques, — car en Allemagne, qui
aurait bien pu posséder quelque expérience dans le domaine de
l'occultisme ? — des voyants, de vrais et de faux prophètes, des
extatiques et des médiums. Des « Loges occultes » plus ou
moins secrètes, anciennes et nouvelles, me furent ouvertes. Et
chaque fois au bout de quelques années, je les quittais sans en
avoir été entamé, après la même expérience : rien ici non plus
! du temps perdu ! des redites sans rien de précis ; des propos
superficiels, un théisme fanatique ! Et dans les cas les plus graves
: l'eau de rose d'une piété quiétiste !
En
Inde, je menai pendant trois mois une vie de fou...
Enfin,
je crus avoir trouvé ce que j'avais cherché si longtemps : une
communauté d'hommes, européens et orientaux, dans l'Inde centrale,
qui prétendaient posséder le véritable secret du yoga, cette
méthode asiatique remontant à la plus haute antiquité qui découvre
le seul chemin permettant d'accéder aux degrés qui se situent loin
au-delà du niveau de la faible, imparfaite et impuissante humanité.
Je fus admis, après avoir répondu de manière apparemment
satisfaisante à des questions extrêmement pertinentes d'ordre
métaphysique et dont la solution relevait plus de l'intuition que de
la raison. Il est écrit entre autres dans mon certificat d'admission
: « Il y a en vous le véritable esprit d'un mystique.» Ensuite,
je reçus toute une série de conseils au sujet du « visage
vert ». A partir de cette époque je menai pendant trois mois
une vie de fou, ne mangeant que des légumes, ne dormant pas plus de
trois heures par nuit, « savourant » deux fois par jour deux
cuillerées à soupe de gomme arabique dissoute dans un potage clair,
— moyen particulièrement efficace pour éveiller la voyance ! —
m'exerçant à minuit à de douloureuses postures d'Asana, les jambes
croisées, retenant mon souffle au point que mon corps se couvrait
d'écume et que je me débattais contre une asphyxie mortelle.
Je
manquais, à un degré surprenant, de la faculté de penser par
images...
Par une
nuit d'hiver où la neige paraissait trop haute pour me permettre de
remonter sur ma colline, je me trouvais assis au bord de la Moldau.
J'avais derrière moi une vieille tour ornée d'une grosse horloge.
J'étais là depuis quelques heures, grelottant malgré ma fourrure,
fixant le ciel noirâtre et m'efforçant par tous les moyens
d'arriver à ce que mes « frères » de l'Inde appelaient dans leurs
lettres la vision intérieure. De nouveau tous mes efforts étaient
vains. Jusqu'à ce jour-là, et cela depuis ma plus tendre enfance,
je manquais à un degré surprenant de cette faculté qui est
accordée à bien des hommes de pouvoir se représenter, en fermant
les yeux, une image ou un visage. Ainsi, il m'aurait été impossible
de dire, par exemple, si telle ou telle personne de mes connaissances
avait les yeux bleus, marrons ou gris, ou un nez droit ou aquilin.
Autrement dit, j'avais coutume de penser avec des mots et non par
images. J'avais décidé, ayant bien présenté à la mémoire, pour
autant que mes facultés me le permettaient, l'image du Bouddha
Gautama, de ne pas quitter l'endroit où j'étais assis avant d'avoir
réalisé fût-ce le moindre petit progrès.
Soudain,
je vis apparaître une horloge géante...
Je
devais bien être là depuis au moins cinq heures lorsque subitement
s'imposa à moi cette question très humaine : quelle heure peut-il
bien être ? Et voilà que, de la manière la plus curieuse, à ce
moment précis où je m'arrachai à ma torpeur, je vis apparaître
dans le ciel une horloge géante projetant une vive lumière, et cela
avec une netteté que je n'avais pas expérimentée dans ma vie
lorsque j'observais des objets réels. Les aiguilles indiquaient deux
heures moins douze. Je sentis nettement les battements de mon cœur
ralentir, et je crus que c'était là une conséquence de l'émotion
ressentie ; c'était une erreur, comme je ne tardai pas à m'en
apercevoir, et le ralentissement du pouls n'était pas la
conséquence, mais la cause de la vision ! J'avais l'impression
extraordinaire qu'une main retenait mon cœur. Je me retournai pour
regarder derrière moi l'horloge réelle de la tour. Elle marquait
aussi deux heures moins douze ! Il est exclu que j'aie pu auparavant
me retourner et avoir ainsi un certain point de repère quant à
l'heure, car j'étais resté assis parfaitement immobile au bord du
fleuve tout au long de ces cinq heures, ainsi qu'il est strictement
prescrit pour les exercices de concentration. J'étais heureux, à
part une légère crainte qui s'insinuait en moi : l'œil intérieur
resterait-il ouvert ?
En
maîtrisant les battements de mon cœur, j'atteins un état d'éveil
anormal...
Je
repris mon exercice. Un moment le ciel demeura noirâtre et fermé
comme auparavant. Subitement l'idée jaillit en moi d'essayer de
réprimer les battements de mon cœur au point où ils avaient été
ralentis lors de la vision, ou même, très probablement, avant la
vision. Ou plutôt, ce n'était pas tellement une « idée » qu'une
déduction à demi formulée du sens d'une phrase du Bouddha Gautama
qui s'était imposée à moi comme une suggestion émise par une voix
en moi : « C'est du cœur que » viennent toutes choses, nées du
cœur et au cœur soumises... » Grâce aux exercices de yoga
pratiqués jusqu'alors j'avais quelque idée de la manière de m'y
prendre pour influer dans une certaine mesure sur les battements du
cœur. Ma tentative réussit. Pour la première fois de ma vie.
Immédiatement je me trouvai dans un état qui m'avait été
totalement étranger jusqu'alors : l'impression intense d'un état
d'éveil anormal. En même temps je vis s'éloigner à ma vue une
portion circulaire du ciel nocturne, comme si une lanterne magique se
mettait à tourner. Comme si elle se détachait de l'atmosphère pour
reculer jusqu'à des profondeurs de plus en plus lointaines,
incommensurables, de l'espace ; tout à coup, il n'y eut plus
d'arrière-plan nulle part, et à mon grand étonnement je me rendis
compte qu'à tout moment et constamment dans la vie nous sommes
environnés d'arrière-plans : le bleu d'azur ou la brume du ciel,
des murs sous quelque forme que ce soit, — et cela sans que nous
nous en apercevions jamais !
Je
considérai les formes géométriques comme un apprentissage à la
voyance...
Dans
cette trouée circulaire qui venait de se former dans le ciel se
trouvait une figure géométrique. Je ne la voyais pas comme on voit
les objets dans la vie courante, de face ou de profil : je la voyais
de tous les côtés en même temps, aussi extraordinaire que cela
puisse paraître comme si mon œil intérieur, au lieu d'une
lentille, était pour ainsi dire un cercle tout autour de la vision.
D'où aussi cette impression nouvelle de l'absence d'arrière-plan !
Cette figure géométrique était le symbole de « in hoc signa
vinces », une croix dans un H. Je la regardai d'un cœur froid
et sans émotion ; aucune trace en moi d'exaltation ou de quoi que ce
fût de semblable. Ce qui est d'ailleurs tout naturel, car je n'avais
guère alors de notion de l'extase. Au bout d'un moment je vis
apparaître d'autres formes géométriques. Je les considérai comme
un a b c de l'apprentissage à la voyance. L'acquisition permanente
que je remportais en rentrant chez moi était de savoir de façon
certaine comment m'y prendre pour obtenir la vision intérieure :
ralentir les battements du cœur, me mettre dans un état d'éveil
très poussé, regarder droit devant moi le plus loin possible pour
réaliser le parallélisme des axes oculaires, etc. Mais tous ces
moyens n'étaient nullement nécessaires bientôt je n'eus qu'a
évoquer mon expérience au bord de la Moldau pour voir les images se
former de nouveau dans l'espace devant mes yeux. Peu de temps après,
j'eus aussi des visions en couleurs d'une telle splendeur et d'un tel
éclat et animées d'une telle vie qu'elles m'aidèrent à traverser
bien des heures difficiles de mon existence. Jamais lors de visions
je ne tombai dans des rêveries ou autres états de conscience
inférieurs à l'état normal de veille. Les visions dont il s'agit
ne dépendent pas de notre libre arbitre ; elles apparaissent selon
le bon plaisir d'une volonté qu'il n'est pas en notre pouvoir de
manifester, bien que ce soit assurément notre volonté et non point
la manifestation d'une puissance extérieure, d'un « Dieu » ou de
quelque nom qu'on l'appelle... C'est cette faculté de voyance qui
fut la cause première de mon activité d'écrivain ; l'impulsion
extérieure mentionnée au début de cet article ne fit que mettre en
marche le mouvement d'horlogerie remonté. Les idées qui me
poussèrent à écrire des histoires fantastiques furent toujours, au
début, des images, des situations ou des personnages aperçus en
vision, qui constituèrent le noyau autour duquel je construisais mes
nouvelles. Bref, j'avais appris à penser par images. Je puis
mentionner en passant que très souvent j'ai eu des visions qui nie
donnaient symboliquement ou ouvertement des avertissements, des
conseils ou des enseignements.
Gustav
Meyrink
Texte
extrait de la revue Merlin, n° 3, de 1949. Verlag
Langen-Muller, Munich, titre original Mein Erwachen als Medium.
Traduction A.-D. Sarnpieri.
Le
visage vert
1916
- Amsterdam est devenue la plaque tournante de l'émigration
européenne. Une foule interlope et grotesque se bouscule dans les
bouges à matelots, les cabarets douteux et une mystérieuse boutique
de prestidigitation au cœur du ghetto. Aristocrates en exil,
escrocs, illusionnistes, kabbalistes et sorciers, tous rêvent à une
nouvelle vie dans un autre monde. Certains fondent leurs espoirs sur
une terre promise au-delà de l'océan, d'autres, au moyen de forces
occultes, cherchent à briser le miroir des apparences dans l'attente
d'une Vérité révélée.
Beaucoup
cèdent à la tentation des sectes et des charlatans mais, dans le
labyrinthe de l'aventure intérieure, seul l'initié au cœur pur
trouvera l'issue. L'ingénieur Hauberisser et la jeune Eva sont de
ceux-ci, ils vivent leur amour comme une quête spirituelle. Le
Visage vert leur apparaît pour les guider, symbole ésotérique qui
donne la vraie dimension de ce roman à clés ; chacun l'interprète
en fonction de ce qu'il est lui-même, accomplissant cette alchimie
qui selon C. G. Jung conduit au Soi, à la part du divin en l'homme.
Le
succès du Golem a trop souvent fait considérer Gustav Meyrink
(1868-1932) comme un
maître du fantastique avec ce que cela comporte de restrictif. Il
importe aujourd'hui de lui rendre sa place dans l'histoire de la
littérature. Très marqué par l'expressionnisme, chef de file du
groupe pragois des écrivains allemands, il fut l'ami de Rilke, de
Max Brod et influença Kafka.